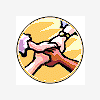
Activités de mise en train : warming up
Par André Jorge, dans Langues vivantes étrangères,
Il s'agit d'activités "d'échauffement", de mise en train.
Exemples :
La date : What's the date today ? What day of the week is it ? What month is it ? [*]L'heure :
What time is it ? Le temps : What's the weather like (today) ? Is it cold (or hot) ? Is it sunny, cloudy or is it raining ?
etc. [*]Parler des enfants :
Shirley has got a new dress ! What colour is it ? Look at Suzy's new bag ! Do you like it ?
etc. [*]Les absences :
Who's absent today ? How many pupils are here ?
- Lire l'article
- 0 commentaire
- 1515 vues
